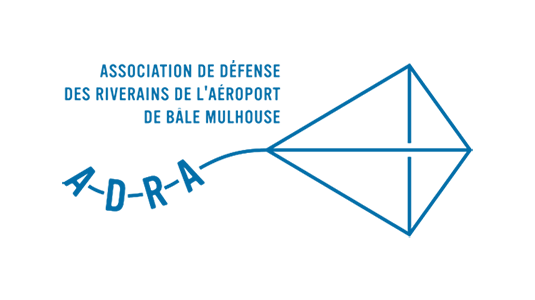Futurologie : Vers un monde sans avion ?
En 2050, récit d’un futur où le ciel s’est vidé
La Croix explore le futur à travers la fiction. Alors qu’en 2025 certains d’entre nous ont déjà arrêté de prendre l’avion, mais que globalement le trafic aérien continue de progresser, projetons-nous en 2050… Futurologie (1/3).
LaCroix, Nathalie Birchem, 15.07.25
Quand j’étais petit, j’avais un rêve : je voulais être pilote d’avion. Mes parents étaient fans de voyages. Ils m’ont appelé Cosmo pour que je grandisse avec l’idée d’explorer le monde. Ensemble, l’été, on est allé à New York, au Japon, au Canada, en Australie, au Sénégal, au Cambodge, au Kenya, en Indonésie, en Colombie. Et, pendant les petites vacances, on visitait une ville d’Europe : Rome, Athènes, Lisbonne, Prague, Barcelone, Dublin, Copenhague, Dubrovnik, Berlin… J’adorais ça. On était heureux. C’étaient les années 2010, le trafic aérien explosait. Je me voyais déjà quand je serai grand, aux commandes dans mon cockpit, dans mon costume d’aviateur, emmener mes parents au Bhoutan.
Mais, quand j’ai eu 9 ans, en 2019, il est arrivé une chose inattendue. Lors d’un repas de famille, la petite sœur de ma mère, une enquiquineuse qui était de toutes les mobilisations pour le climat, a commencé à nous prendre la tête. Elle sortait avec un Suédois et il paraît que là-bas, à l’époque, ils avaient honte de voler. Le flygskam, ça s’appelle. Soi-disant que si on n’arrête pas de prendre l’avion, on n’arrivera jamais à l’objectif fixé par l’Accord de Paris en 2015 de limiter à 1,5 °C le réchauffement climatique par rapport à l’ère préindustrielle.
« Et la voiture, elle pollue pas peut-être ? », s’est défendue ma mère, piquée au vif, dès le plat d’asperges mayo. « Si, la bagnole, comme c’est le moyen de transport le plus courant, elle pollue beaucoup bien sûr. Mais si tu compares en grammes de CO2 par heure de trajet, c’est 20 fois moins que l’avion », a répliqué la tantine, en piochant dans son dhal de lentilles et nous dans notre poulet-frites. « Est-ce que tu sais qu’avec un Paris-New York en avion, tu produis deux tonnes de CO2, soit l’équivalent de ce que tu devrais émettre en une année entière si tu voulais arrêter de cramer la planète ? », a-t-elle ajouté en se servant de la salade de fruits, avant d’asséner, perfide, en sirotant sa chicorée : « Et je ne vous parle même pas de vos petites virées à Bogota, Djakarta ou Sydney… »
« À 16 ans, j’ai esquivé la Bretagne et fugué pour aller au Salon du Bourget. »
Ça a jeté un froid… À partir de là, ma mère a vrillé. Elle a commencé à calculer notre empreinte carbone. L’année d’après, il y a eu la pandémie du Covid et les voyages internationaux ont complètement cessé. Pendant les vacances d’été, on a connu la pluie en Bretagne. Ma mère a trouvé ça absolument charmant. Elle n’a plus jamais voulu prendre l’avion. Mon père a à peine lutté. J’étais consterné. Pendant ce temps-là, tous mes copains succombaient aux joies des Paris-Lisbonne à 45 €. J’ai eu une adolescence difficile. À 16 ans, j’ai esquivé la Bretagne et fugué pour aller au Salon du Bourget.
Aujourd’hui, j’ai 40 ans. On est en 2050 et le monde a bien changé. Désormais, le trafic aérien mondial est tombé à 50 % de son niveau record de 2019. En France, on est passé de 30 % de la population qui prenait l’avion au moins une fois par an en 2025 à moins de 3 % aujourd’hui. Ce n’est pas encore suffisant, paraît-il, pour sauver la terre. Mais c’est plus que ce qu’espéraient les experts. Désormais, il n’est plus impossible, que, conjugué aux efforts des autres secteurs économiques, on arrive à limiter à 2 °C l’augmentation des températures en 2100. Je vais vous raconter comment c’est arrivé.
En 2030, j’ai eu 20 ans et j’ai intégré une école d’ingénieur aéronautique. Mes parents ont pensé un temps me couper les vivres, mais je leur ai dit que je voulais travailler sur l’avion propre du futur. J’ai fait un stage dans une start-up qui a lancé en 2028 le premier modèle commercial de l’avion hybride électrique. Un modèle de 19 places avec une autonomie de 1 000 kilomètres. Mais, avec le poids des batteries, on n’a jamais pu envisager de faire des avions significativement plus gros. Tous les jeunes ingénieurs rêvaient alors de l’avion à hydrogène, qui devait, lui, transporter entre 100 et 200 passagers pour faire entre 2000 et 4 000 kilomètres. Mais Airbus n’arrêtait pas de reporter le projet.
En 2035, je suis aussi allé faire ma thèse sur les nouveaux carburants d’aviation, aux États-Unis, en profitant de la bourse Fly Baby Fly, lancée par Donald Trump, devenu « empereur des Très Grands États-Unis d’Amérique », pour récupérer les diplômés européens déçus par les lenteurs du Vieux Continent.
À l’époque, le secteur aérien européen misait sur le remplacement du kérosène pour les sustainable aviation fuel (SAF), les carburants d’aviation durables, notamment ceux fabriqués à partir de biomasse. Pour fournir la matière première, l’industrie aérienne a converti des hectares et des hectares de surfaces agricoles, au détriment des cultures alimentaires, dont les prix ont explosé. La révolte a commencé en 2036 en France, avec un attelage inédit rassemblant agriculteurs céréaliers, militants de la gauche radicale, associations de consommateurs, confréries des buveurs de vin et patrons de la grande distribution.
Juchés sur des tracteurs et des vélos, les manifestants ont déversé du SAF pourri sur le tarmac de Paris-Charles-de-Gaulle, avec des slogans comme « Mon potiron plutôt que ton avion », « C’est pas les SAF qui vont étancher ma soif » ou encore « Jet l’éponge ». À la surprise générale, en quelques mois, des dizaines de milliers de citoyens européens ont bloqué les aéroports de toute l’Union européenne. Dont mes parents sexagénaires, avec leur tee-shirt floqué « Chom war an douar » (« Reste sur terre » en breton).
Aux élections anticipées qui ont suivi, dans plusieurs pays d’Europe, les coalitions de droite et d’extrême droite au pouvoir ont laissé la place à des partis néo-écologistes. Dont les premières mesures ont été de plafonner les capacités des aéroports et de taxer drastiquement les billets d’avion pour donner un coup d’arrêt à la croissance du trafic aérien, et freiner ainsi les besoins de SAF. Les prix des voyages ont alors augmenté de 500 % en Europe. Pas tellement plus finalement qu’aux États-Unis, qui ont, eux, investi dans les e-SAF, les électro-carburants d’aviation durable, dont le coût de revient, cinq à dix fois plus cher que celui du kérosène, a aussi fait flamber les prix.
« Le fait de partir en vacances en avion est globalement devenu ringard. »
Bref, aujourd’hui, en 2050, un vol Paris-Sydney coûte 8 400 €, six fois plus que quand j’y suis allé avec mes parents. Autant dire que ça a calmé beaucoup de gens. Le trafic aérien en général a largement décru. Côté déplacements professionnels, pour garder leurs exonérations fiscales, les multinationales ont fait de gros efforts pour limiter leurs vols intercontinentaux, et les réunions en visio, cravate au-dessus du bureau, bermuda en dessous, sont devenues la norme. Côté loisirs, pour 90 % des êtres humains qui n’avaient jamais pris l’avion, ça n’a rien changé. Parmi les 10 % restants, le fait de partir en vacances en avion est globalement devenu ringard. Notamment en Europe, où les gouvernants se sont enfin décidés à investir massivement dans le train, y compris les trains de nuit, en achetant des modèles chinois capables de dépasser les 500 km/h.
Bien sûr, tous ces changements ne se sont pas faits sans casse. Comme des dizaines de milliers d’employés de l’aérien et du tourisme international, j’ai perdu mon boulot d’ingénieur en décarbonation. Mais j’ai rebondi. Je suis devenu consultant indépendant en voyage responsable. Je conseille des millionnaires qui veulent se payer un beau voyage dans un avion décarboné et expier en devenant végétarien, cycliste ou en jetant leur portable. Là, par exemple, j’ai un couple de Chinois qui, pour pouvoir faire un tour du monde, veut planter 2 000 hectares de forêt en Amazonie.
Pour cela, je suis en contact avec Gaïa, une Grecque de Corfou qui a créé sa boîte d’ingénierie en captation de carbone. En visio, elle me raconte que depuis que les avions ont arrêté de déverser des touristes par milliers, son île, moins surfréquentée, se porte mieux. Les paysages se reconstituent et l’économie commence à se recréer autour des besoins des habitants plutôt que ceux des touristes.
J’avoue que je suis un peu amoureux de Gaïa. J’aimerais tant revêtir mon costume d’aviateur et l’emmener au bout du monde dans mon cockpit. Et expier en n’ayant pas d’enfants. En attendant, j’ai pris mon billet pour Corfou. Depuis Châteauroux, dans l’Indre, où je suis installé, le trajet en train plus bateau dure vingt-neuf heures. Je ne lui apporterai pas de fleurs, car les fleurs, c’est périssable. Plutôt des bonbons, c’est tellement bon. N’est-ce pas romantique ?